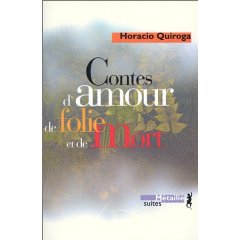QUIROGA Horacio, Contes d'amour, de folie et de mort, Éditions Métailié, Coll. Suites, 2000
L'Insolation
"Old, le chiot, sortit par la porte et traversa la cour d'un pas droit et paresseux." Il s'installa et observa les alentours. Tout était calme. "Pas un nuage, pas un souffle de vent."
Milk, le père, alla retrouver son chiot et s'assit à ses côtés. Old continuait d'observer l'orée du bois qu'il regardait depuis un moment.
Il estimait que la matinée était fraîche. Milk, quant à lui, observait deux faucons dans un arbre.
Le regard des chiens se portait ici ou là.
"Cependant le ciel à l'orient commençait de s'empourprer et l'horizon avait déjà perdu sa netteté matinale." Puis le soleil se leva. D'autres chiens vinrent rejoindre Old et Milk. Les cinq fox-terriers finirent par s'endormir.
"Au bout d'une heure ils levèrent la tête." Leur maître se déplaça dans la maison. Les chiens le reconnurent à sa démarche. L'homme "avait encore le regard mort et la lèvre pendante, après une veillée solitaire au whisky plus prolongée que de coutume."
Les chiens s'approchèrent de lui un instant, puis s'installèrent dans les couloirs. Il faisait toujours chaud comme habituellement à cette saison.
M. Jones, le propriétaire des chiens, se rendit dans les champs. Tandis qu'il faisait la sieste l'après-midi, les péons vinrent travailler aux champs. Les chiens leur tinrent compagnie. La chaleur était toujours aussi forte et les chiens toujours allongés. Devant une petite étendue de terre, le "chiot vit soudain mister Jones qui le regardait fixement assis sur un tronc. Old se leva en remuant la queue. Mais les autres, qui se levèrent aussi, avaient le poil hérissé."
Le chiot, "surpris par l'attitude des autres", ne comprit pas ce qui arrivait. Ce fut Prince qui lui annonça que ce n'était pas son maître qu'il avait vu mais la Mort. Puis mister Jones disparut.
Comme les chiens continuaient d'aboyer, les péons regardèrent, dans leur direction, sans rien voir.
Sur le chemin qui conduisait les chiens à la ferme, le jeune chiot" apprit de l'expérience de ses compagnons que quand une chose va mourir, elle apparaît d'abord."
Les chiens restèrent tout l'après-midi auprès de leur maître, attentifs au moindre bruit, ce qui rassura leur maître.
La nuit tomba. Les chiens se placèrent autour de la maison, leur maître au premier étage. Les chiens, sentant sa mort approcher, se lamentaient sur leur sort. Ils auraient fatalement un autre maître, mais comment serait-il ?
Le lendemain matin, mister Jones travailla, sans être satisfait de ce qu'il avait accompli, sa herse étant en mauvais état.
À midi, après avoir donné quelques consignes au péon, il alla déjeuner et fit la sieste. Les chiens étaient toujours là.
La chaleur était accablante. Les chiens, tout en se reposant, constatèrent que leur maître n'avait pas reparu. Les chiens continuaient d'observer. Enfin leur maître revint au même moment que le péon et le cheval.
La mort, que les chiens avaient perçue, venait de prendre le cheval que le péon avait fait courir sous cette chaleur. Ce fait rassura les chiens.
Cependant mister Jones dut retourner en ville car il manquait une vis pour sa herse. Le chemin fut éprouvant à cause de la chaleur. Il eut des vertiges.
Dès que les chiens le virent, ils comprirent que le sort de leur maître était scellé. Mister Jones s'écroula et mourut. La propriété fut vendue par le demi-frère de mister Jones. Chaque péon prit un chien "qui [vécut] dès lors maigre et galeux et [alla] en secret chaque nuit, affamé, voler des épis de maïs dans les fermes voisines."
Les barbelés
L'alezan ne parvenait pas à comprendre quel était le chemin par lequel son compagnon s'échappait. Puis un jour, le vieil alezan "trouva très simplement la brèche." Il put enfin suivre le chemin qui le menait jusqu'à la forêt et retrouver son compagnon.
Les deux chevaux étaient libres mais dans leur marche, une nouvelle clôture les arrêta. Alors ils passèrent la tête par dessus. De là ils virent "un haut pâturage sur un ancien essart, blanc de givre ; une bananeraie et des plantations nouvelles." Ils parvinrent à passer cette clôture puis la suivante. Le sentiment de liberté était immense car ils n'avaient connu que l'enclos.
Leurs pas les conduisirent jusqu'à un troupeau de vaches. Une discussion s'engagea durant laquelle les chevaux apprirent que seul le taureau était capable de franchir une clôture. Les chevaux réalisèrent soudain qu'il existait une différence entre eux et le taureau. Cependant le taureau eut beaucoup de mal avec la clôture car "le fermier, heureux propriétaire du champ d'avoine, avait assuré […] sa barrière avec des coins."
Le taureau parvint toutefois à la franchir mais s'égratigna un peu le dos et se vit forcer, par le fermier voisin, de bouger. Le taureau n'obéit pas longtemps, il "enfonça sa tête entre les fils et traversa dans le grincement des fils de fer et des crampons qu'on lui lançait à vingt mètres de là."
Tout ceci eut lieu sous les yeux des chevaux qui "retournèrent par le chemin vers leur champ." Les chevaux suivirent l'homme qui se rendait dans la "ferme du propriétaire du taureau."
Les chevaux entendirent la conversation des deux hommes. Le fermier ne parvenait plus à supporter les nombreux pillages de ce taureau qui appartenait à un Polonais, quelque peu sournois.
Le fermier annonça qu'il allait mettre des barbelés, ce qui n'impressionna pas le Polonais.
Les chevaux, quant à eux, retournèrent "à l'endroit où Barigüi [le taureau] avait accompli sa prouesse." L'animal était toujours là.
Quand les vaches aperçurent les chevaux, elles les méprisèrent. Les chevaux vinrent leur annoncer que le taureau ne pourrait plus passer. Si les vaches n'y crurent pas, les chevaux estimèrent que l'homme construirait quelque chose d'infranchissable.
Alors qu'ils continuaient de marcher, les chevaux aperçurent le fermier "qui changeait tous les piquets de la clôture et un homme blond, arrêté à côté de lui sur son cheval, qui le regardait travailler."
Le fermier persista, le taureau ne passerait plus.
Les chevaux poursuivirent leur balade et "rentrèrent dans leur champ par le portail."
Le lendemain, les chevaux "renouvelèrent leur escapade." Ils arrivèrent non loin du pré des vaches. Ils voulurent voir la nouvelle clôture faite de "deux simples fils de fer barbelés, gros peut-être, mais seulement deux" et de piquets peu espacés.
Les chevaux doutèrent de l'efficacité de ces barbelés malgré les paroles entendues la veille.
Les vaches aperçurent les chevaux. Le taureau, qui mangeait l'avoine étant passé par derrière, expliquèrent les vaches, mais il pourrait passer ces barbelés au fil très tendu ajoutèrent-elles.
Tout à coup, le fermier sortit de chez lui et se dirigea vers le taureau. Le fermier, bien qu'armé d'un bâton, semblait serein. Le taureau fonça sur le fermier et passa la clôture, mais "de son dos et son ventre déchirés, par une tranchée profonde de la croupe au poitrail, pleuvaient des fleuves de sang." Le taureau finit par s'effondrer. Le Polonais dut l'abattre.
"Le lendemain [l'un des chevaux] eut le privilège de rapporter, dans ses sacoches, deux kilos de la viande du taureau mort."
FIN DE LA QUATRIÈME PARTIE




 S
S